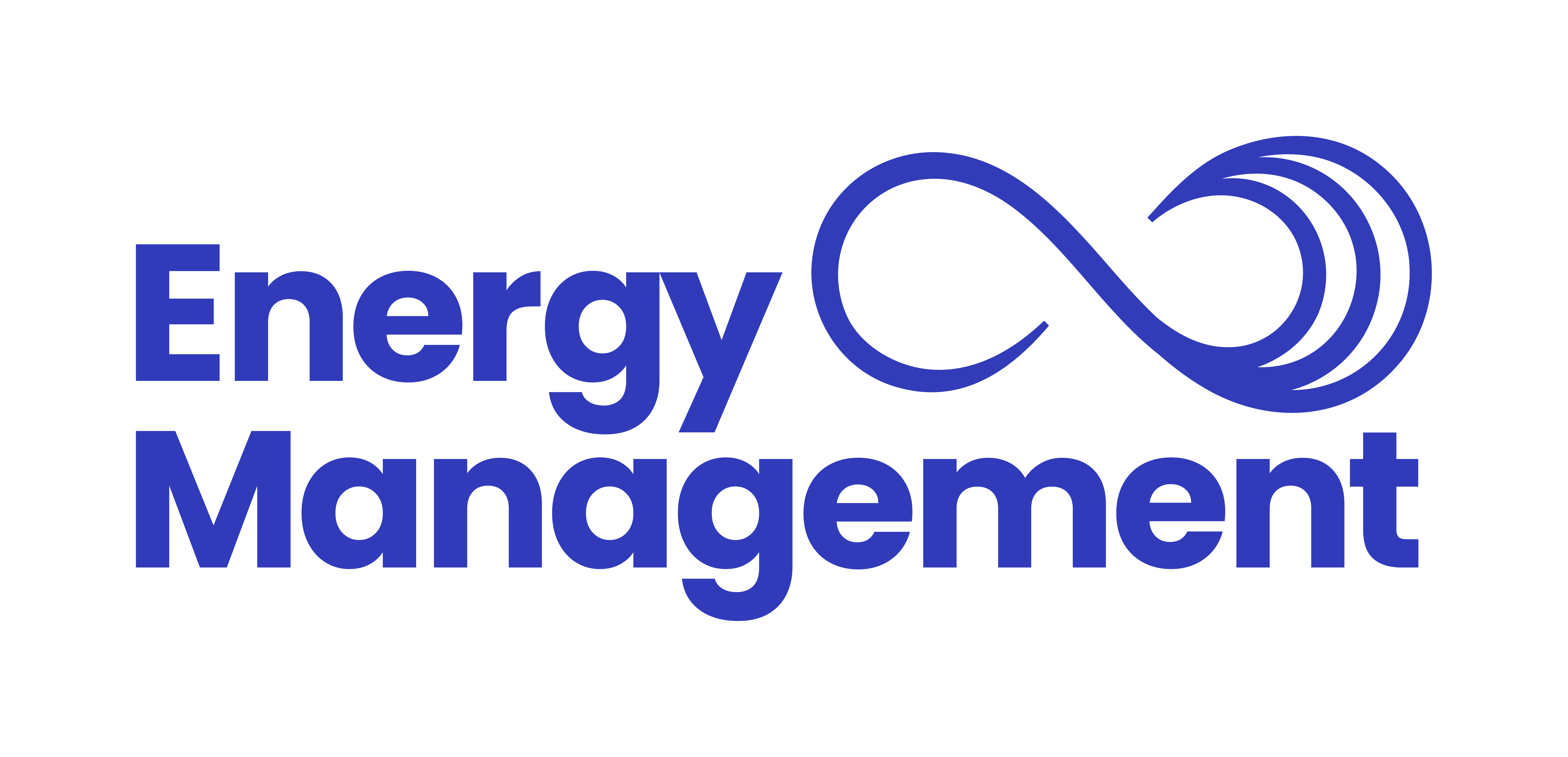Norme SIA 390/1 : Vers une évaluation systématique du bilan carbone des bâtiments
Sommaire
Introduction et contexte
Le secteur du bâtiment représente près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle mondiale. En Suisse, la transition vers des constructions à faible impact carbone devient une priorité absolue, et la nouvelle norme SIA 390/1 – « La voie du climat » marque une avancée décisive.
🔎 Pourquoi une nouvelle norme ?
La norme SIA 2040, en vigueur depuis 2011, proposait une méthodologie pour concevoir des bâtiments à faible impact carbone. Toutefois, elle ne permettait pas une approche standardisée et transparente du bilan GES sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments. La SIA 390/1 vient remplacer et affiner cette approche en définissant des valeurs cibles précises et une méthodologie d’évaluation plus rigoureuse.
📊 Les principes fondamentaux de la SIA 390/1
L’innovation majeure de cette norme est qu’elle établit un cadre quantitatif structuré pour mesurer et réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Elle s’appuie sur trois piliers principaux :
Un périmètre d’analyse étendu : une approche cycle de vie
Contrairement aux anciennes pratiques qui se concentraient sur les seules émissions d’exploitation (chauffage, électricité, etc.), la SIA 390/1 adopte une vision plus large en intégrant trois composantes essentielles :
- Matériaux et construction 🏗️ : extraction, fabrication, transport, mise en œuvre et fin de vie des matériaux.
- Exploitation 🔥 : consommation énergétique et émissions liées à l’utilisation du bâtiment.
- Mobilité associée 🚗 : impact des déplacements générés par l’usage du bâtiment (résidentiel, bureaux, commerces).
💡 Pourquoi inclure la mobilité ?
L’impact des déplacements des usagers peut parfois dépasser celui de la construction ou de l’exploitation d’un bâtiment. La norme encourage donc une implantation optimisée (proximité des transports en commun, accessibilité des services).
Des valeurs cibles pour une conception bas carbone
La SIA 390/1 fixe des valeurs seuils d’émissions de CO₂ équivalent (kgCO₂e/m².an) pour les bâtiments, en fonction de leur usage (logements, bureaux, écoles, etc.). Ces valeurs tiennent compte :
✅ De la performance énergétique du bâtiment (isolation, efficacité des systèmes techniques).
✅ De la sobriété des matériaux (choix des matériaux biosourcés, recyclés, réemployés).
✅ De la durée de vie des composants et de leur impact environnemental global.
📏 Exemple de valeurs cibles (indicatives, à affiner selon la documentation officielle) :
- Logements : ≤ 10 kgCO₂e/m².an
- Bureaux : ≤ 12 kgCO₂e/m².an
L’approche repose sur un budget carbone maximal à respecter sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (construction + exploitation sur 60 ans).

Méthodologie d’évaluation : des outils de calcul standardisés
Méthodologie d’évaluation : des outils de calcul standardisés
La norme impose une transparence des calculs et recommande l’utilisation de bases de données et d’outils reconnus pour évaluer les impacts environnementaux.
🔬 Parmi les outils couramment utilisés :
- KBOB : base de données suisse des écobilans des matériaux de construction.
- SIA 2032 : méthode d’évaluation énergétique des bâtiments.
- SIA 2040 (ancienne version, qui reste une référence partielle).
Les projets doivent justifier leur performance carbone via un bilan détaillé en ACV (Analyse du Cycle de Vie), conformément aux principes de la norme ISO 14040.
Le contexte spécifique de la Suisse romande
En Suisse romande, la prise de conscience des bénéfices du commissioning est en nette progression, notamment sur les projets :
- De bâtiments certifiés Minergie ou Minergie-ECO.
- De projets tertiaires ambitieux (bureaux, écoles, hôpitaux, bâtiments industriels).
- D’immeubles soumis à des normes élevées de performance énergétique (label SIA, standards municipaux).
Certaines communes et cantons commencent même à exiger un commissioning formel pour l’obtention de certaines autorisations ou subventions.
En parallèle, la pénurie de ressources techniques qualifiées renforce l’intérêt du commissioning : il devient un outil précieux pour éviter les erreurs coûteuses dès la phase projet.
Conclusion
Le commissioning est bien plus qu’une option : c’est une véritable assurance qualité pour l’avenir du bâtiment. Dans un monde où la performance énergétique et le confort des utilisateurs sont devenus des priorités, intégrer un processus de commissioning rigoureux est une démarche stratégique, tant pour les promoteurs que pour les ingénieurs, architectes et exploitants.
Notre bureau d’ingénieurs s’engage pleinement dans cette dynamique, en proposant des prestations de commissioning adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet.
Envie d’en savoir plus sur notre approche du commissioning ?
N’hésitez pas à nous contacter : nous serions ravis d’échanger sur vos projets futurs !