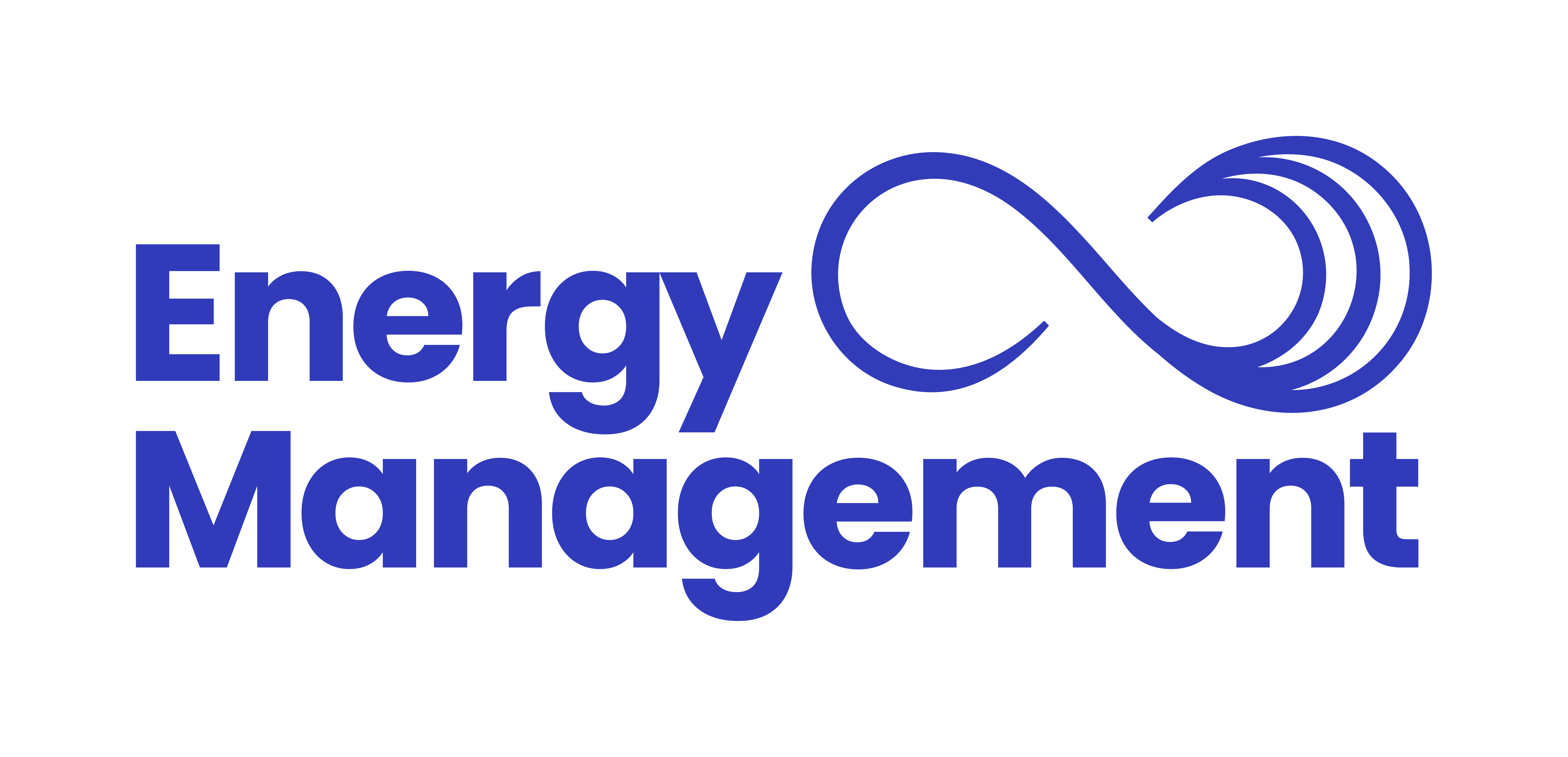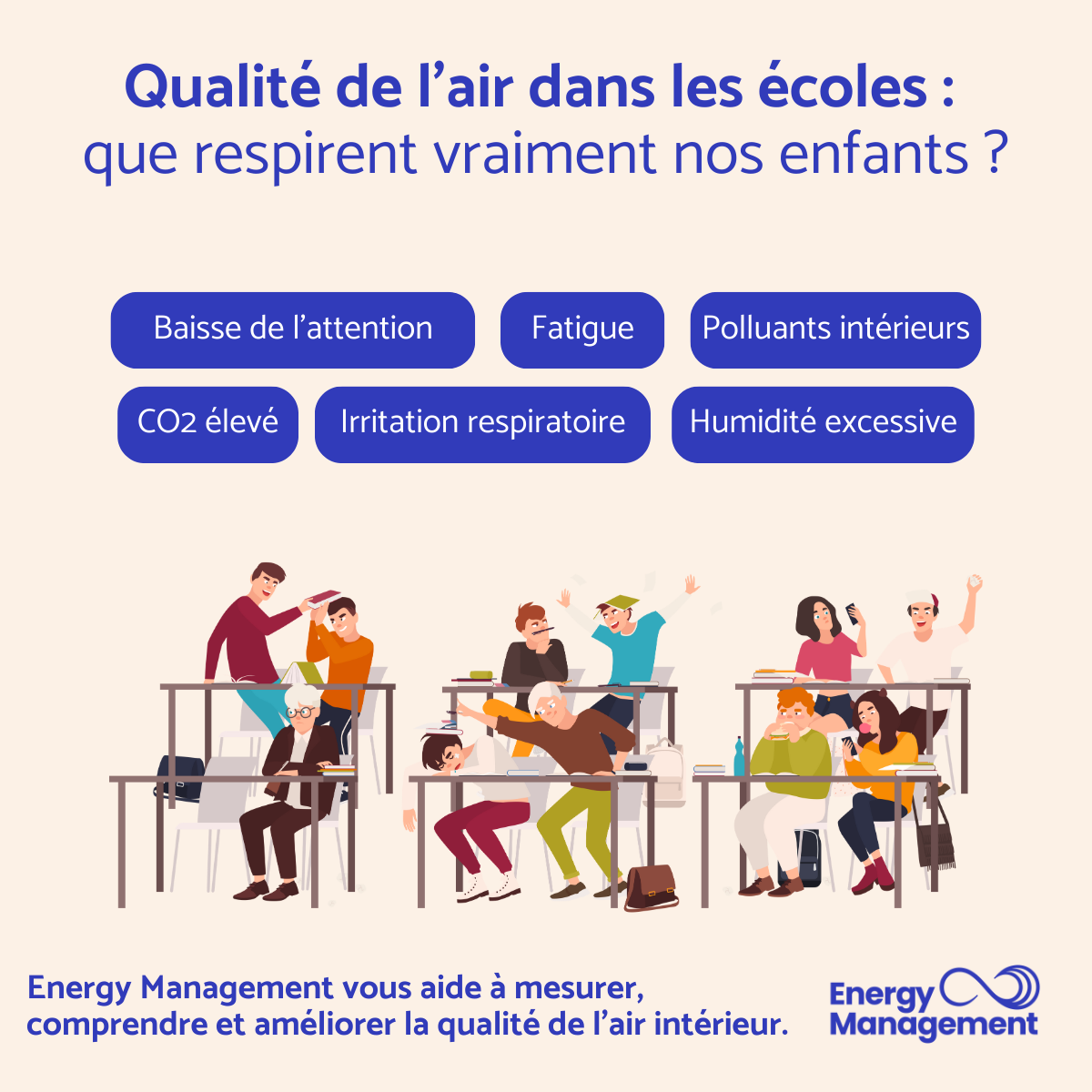Optimisation énergétique dans l’industrie : leviers techniques et retour sur investissement
Sommaire
Introduction
Face à l’augmentation continue des coûts de l’énergie et aux exigences croissantes en matière de durabilité, l’industrie se trouve à un tournant stratégique. Réduire la consommation énergétique n’est plus seulement un enjeu écologique, mais un levier direct de performance économique et de compétitivité. Pour de nombreuses entreprises, l’optimisation énergétique offre des opportunités concrètes d’économies avec des retours sur investissement rapides.
Cet article propose une synthèse des principaux leviers d’optimisation énergétique dans les installations industrielles et analyse leur impact en termes de retour sur investissement (ROI).
Les fondamentaux de l’optimisation énergétique
1.1 Comprendre les postes énergivores
Dans l’industrie, les principales consommations énergétiques proviennent :
- Des procédés thermiques (chauffage, cuisson, fusion, etc.) ;
- Des systèmes de ventilation, de froid ou de compression ;
- Des moteurs électriques (pompes, ventilateurs, compresseurs).
Le premier pas d’une démarche efficace consiste à réaliser un audit énergétique structuré, qui permet de hiérarchiser les postes selon leur potentiel d’amélioration.
1.2 Déployer un pilotage énergétique ciblé
Le suivi des consommations à l’aide d’outils de Monitoring (Compteurs, sondes, IoT) couplé à une solution de supervision / GTC permet de détecter rapidement les dérives et de visualiser les gains obtenus. L’intégration d’indicateurs de performance énergétique (kWh/unité produite, kWh/m², etc.) est essentielle pour piloter une stratégie d’amélioration continue.
Les leviers techniques d’efficacité énergétique
2.1 Optimisation des process industriels
Le process étant au cœur des industries le gisement d’économie est sous-exploité pour les raisons suivantes : arrêt des lignes, peur de faire une mauvaise manip, budgets travaux différents, méconnaissances des sujets énergétiques des chefs de lignes etc. Des actions typiques incluent :
- L’optimisation des réseaux d’air comprimé (détection de fuites, régulation par variateur);
- La récupération de chaleur sur les compresseurs ou les groupes froids ;
- Le remplacement des moteurs ;
- La régulation optimisée de la ventilation et du chauffage.
Ces actions combinent généralement faible coût d’investissement et retour rapide, en particulier dans les installations anciennes.
2.2 Récupération d’énergie
La récupération de chaleur est un levier à fort impact, notamment dans les procédés générant des rejets thermiques importants (fumées, eau chaude, air extrait). Cette énergie peut être réutilisée pour :
- Le préchauffage d’eau de process ;
- L’alimentation d’un réseau de chauffage ;
- Le couplage avec une pompe à chaleur pour produire de l’eau chaude sanitaire.
2.3 Amélioration de l’enveloppe et des systèmes CVC
Même dans un environnement industriel, l’enveloppe thermique (isolation, étanchéité, vitrages) et les systèmes de ventilation méritent une attention particulière. Des améliorations ciblées permettent d’alléger les charges thermiques et de mieux maîtriser les conditions d’ambiance, notamment dans les zones de travail sensibles. Les architectes devraient consulter les ingénieurs CVC dès le début des projets pour optimiser les volumes, les espaces et la gestion des énergies.

Commissioning et rétro-commissioning
Le commissioning, ou mise en service planifiée, constitue un outil transversal pour garantir la performance des installations dès leur conception. Il s’agit de vérifier que les systèmes énergétiques (CVC, éclairage, GTB, etc.) fonctionnent selon les exigences initiales et de les ajuster si nécessaire.
Dans les bâtiments ou sites existants, le rétro-commissioning permet d’identifier les écarts de performance, les surconsommations, ou les défaillances invisibles. Selon les études, ces démarches peuvent générer jusqu’à 20 % d’économies d’énergie, avec un temps de retour moyen inférieur à 2 ans pour les sites existants.
Évaluer le retour sur investissement
Les retours économiques des actions d’optimisation varient selon la complexité du site et le niveau de départ. Voici quelques exemples typiques :
Action | Économie attendue | Coût estimé | TRI moyen |
Commissioning neuf | 10–15 % | ~11 CHF/m² | 4 ans |
Rétro-commissioning | Jusqu’à 30 % | ~2.75 CHF/m² | 1.5–2 ans |
Récupération chaleur sur compresseur | 15–25 % | CHF 15’000–30’000 | 2–3 ans |
Réduction des pertes d’air comprimé | 10–30 % | CHF 5’000–10’000 | < 2 ans |
Ces données démontrent que les temps de retour sont souvent inférieurs à 3 ans, voire plus courts encore pour les mesures à faible investissement.
Conditions de réussite
Mettre en œuvre une démarche d’optimisation efficace suppose plusieurs conditions :
Un engagement de la direction, essentiel pour prioriser les actions et mobiliser les ressources.
Des compétences internes ou externes, pour diagnostiquer, concevoir et suivre les mesures.
Une logique de progrès continu, s’appuyant sur des données physiques fiables et des retours d’expérience.
L’optimisation énergétique ne se limite pas à un « one-shot », mais s’inscrit dans un processus dynamique, à consolider et enrichir dans le temps.
Conclusion
L’optimisation énergétique dans l’industrie combine rigueur technique et pragmatisme économique. En s’appuyant sur des outils éprouvés, audit, monitoring, commissioning, modernisation ciblée. Les industriels peuvent réduire significativement leurs consommations tout en renforçant la fiabilité de leurs installations. Avec des retours sur investissement courts, ces démarches s’imposent désormais comme un pilier incontournable de la stratégie industrielle durable.